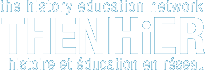Les couturiers canadiens, de discrets pionniers
18 May 2015 - 8:18am
Pourquoi certains domaines et ceux qui y œuvrent au quotidien ignorent-ils leurs prédécesseurs? Face à cette interrogation, la mode canadienne ne fait pas figure d’exception. En effet, nous avons constaté dernièrement que bien des étudiant(e)s et des professionnels négligent leur patrimoine. Certes, une fois le premier obstacle franchi, celui selon lequel cette notion serait passéiste, nous émettons l’hypothèse que si la mode est peu intéressée par son passé, cela provient peut-être de la nature de son système, de sa quête incessante pour l’éphémère. Si cela s’avérait, elle serait alors parfaitement en accord avec la modernité dans laquelle elle est apparue, s’est affranchie du costume et a continué d’évoluer depuis l’ouverture de la maison de nouveautés Worth & Bobergh, à Paris, durant l’hiver 1857-58.
Mais, cette absence actuelle de reconnaissance, n’en implique pas pour autant une de faits et de précurseurs. Certes, plusieurs de ces derniers travaillaient ici anonymement, n’ayant pas pignon sur rue, dans l’ombre d’une clientèle privée, mais il reste que certains ont essayé de faire reconnaître leur travail. C’est donc à eux que nous nous attarderons, soit plus particulièrement à ceux qui exercèrent dans la période de l’entre-deux-guerres, puis aux membres de la première association de créateurs en mode dans l’histoire canadienne, l’Association des couturiers canadiens (ACC). Par le biais d’un propos historiographique, nous tenterons de démontrer que leurs réalités, leurs préoccupations ne sont peut-être pas aussi éloignées des nôtres.
Comme mentionné, il y a des antécédents dans la couture canadienne, voire plus particulièrement montréalaise. Les cas de Gabrielle « Gaby » Bernier (1901-1976) et d’Ida Desmarais (1887-1946), qui rivalisaient en habillant les plus élégantes du Golden Square Mile entre le milieu des années 1920 et, pour la première, jusqu’au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, prouve qu’il est erroné de croire que nos parents s’habillaient selon une mode en retard face aux développements à l’étranger de la mode, dont Paris représentait la capitale en matière de bon goût. Ce mythe lié à la perception de la grande ville comme un lieu de perdition, nie cette diffusion de la presse féminine locale et étrangère, distribuée ici par nos réseaux ferroviaires. À cela s’ajoute aussi le fait, que Madame Bernier, comme d’autres confrères, traversait annuellement l’Atlantique pour assister aux défilés et en rapporter des idées, lorsque ce n’était pas des modèles. Aussi, les prix que pratiquaient ces deux créatrices, qui s’apparentaient parfois à ceux de certaines maisons parisiennes, prouvent que leurs vêtements concurrençaient avec ce qui se faisait de mieux que ce soit en qualité et en création. Et, la présence d’un représentant du soyeux lyonnais, Bianchini-Férier, durant cette période à Montréal, s’ajoute à cette démonstration quant à notre importation, voire adhésion aux nouveautés d’ailleurs et cela encore aujourd’hui.
Le temps s’écoulant, c’est à l’apogée de la haute couture, soit la décennie comprise entre 1947 et 1957, dates qui correspondent au premier défilé de Christian Dior (1905-1957) et à son décès, qu’est fondée au printemps 1954, l’Association des couturiers canadiens. Bien que Raoul-Jean Fouré (1904-1992) en soit le premier président, il semble que l’initiative revient à Jacques de Montjoye (1928), ce que fait croire une mention quant à des échanges préalables entre ce dernier et Marie France de Paris (?). Bien que ce point reste à éclaircir, nous retenons que cette volonté d’un regroupement était dans l’air du temps. Ainsi, à ces trois couturiers montréalais se joindront comme membres fondateurs, France Davies (1927-1999), Colpron D’Anjou (?-196?), Jacques Michel (?), et le duo Germaine et René (?), rejoints par des créateurs de Toronto, d’Ottawa, de St. Catherines et, dans un futur proche, d’autres créateurs de Montréal, dont celle que les historiens de la mode d’ici considèrent comme la « grande dame de la couture montréalaise », Marie-Paule Nolin (1908-1987). Bref, durant les quatorze années d’existence de l’ACC, en rotation, de 10 à 15 couturiers adhéreront au groupe annuellement.
 Comme cas d’études, l’apprentissage du métier de France Davies et de Marie-Paule Nolin sont intéressants, car ils explicitent deux parcours différents, mais qui évoluaient en parallèle à l’époque. En effet, celui de Madame Davies, qui débute en 1947, correspond plus à celui des étudiant(e)s en mode d’aujourd’hui, puisqu’elle a acquis les connaissances de la coupe à l’École de Guerre-Lavigne, et le dessin à l’École Dupéré, toutes deux situées à Paris. Outre l’attrait de la capitale française mentionnée précédemment, il faut savoir que c’est seulement à partir de 1946, qu’ouvre l’École centrale des arts et métiers, connue ensuite sous l’appellation des métiers commerciaux de Montréal, et qui jusqu’à l’avènement des programmes collégiaux dans les années 1970, restera une des références dans la formation en haute couture au Québec. À la différence, Madame Nolin, plus âgée que sa consœur, ne possède aucune formation officielle en création de mode. À l’exemple de Gabrielle « Coco » Chanel (1883-1971), elle approfondit ses connaissances de façon autodidacte, soit en travaillant pour d’autres, dont Raoul-Jean Fouré, un point commun qu’elle partage avec France Davies, ou en fréquentant et s’associant avec des gens qui ont une expérience du milieu. Par exemple, pour l’aider, la guider lors de l’ouverture de son premier salon, elle engage la première d’atelier de Lucien Lacouture (189(5)-1934), Hernance Ferland (?), récupérant ainsi une partie de la clientèle du défunt couturier.
Comme cas d’études, l’apprentissage du métier de France Davies et de Marie-Paule Nolin sont intéressants, car ils explicitent deux parcours différents, mais qui évoluaient en parallèle à l’époque. En effet, celui de Madame Davies, qui débute en 1947, correspond plus à celui des étudiant(e)s en mode d’aujourd’hui, puisqu’elle a acquis les connaissances de la coupe à l’École de Guerre-Lavigne, et le dessin à l’École Dupéré, toutes deux situées à Paris. Outre l’attrait de la capitale française mentionnée précédemment, il faut savoir que c’est seulement à partir de 1946, qu’ouvre l’École centrale des arts et métiers, connue ensuite sous l’appellation des métiers commerciaux de Montréal, et qui jusqu’à l’avènement des programmes collégiaux dans les années 1970, restera une des références dans la formation en haute couture au Québec. À la différence, Madame Nolin, plus âgée que sa consœur, ne possède aucune formation officielle en création de mode. À l’exemple de Gabrielle « Coco » Chanel (1883-1971), elle approfondit ses connaissances de façon autodidacte, soit en travaillant pour d’autres, dont Raoul-Jean Fouré, un point commun qu’elle partage avec France Davies, ou en fréquentant et s’associant avec des gens qui ont une expérience du milieu. Par exemple, pour l’aider, la guider lors de l’ouverture de son premier salon, elle engage la première d’atelier de Lucien Lacouture (189(5)-1934), Hernance Ferland (?), récupérant ainsi une partie de la clientèle du défunt couturier.
Quant à la mission du regroupement, il est possible d’établir un parallèle entre elle et celle qui prévaut actuellement au Conseil des créateurs de mode du Québec (CCMQ). Dans une optique de promotion et le développement d’une identité culturelle nationale soutenue rapidement par le Ministère fédéral du Commerce, et qu’explicite aussi l’emploi des noms « Algonquin », « Mount Royal » et « Jasper Blue » pour désigner certains modèles, bien que cette échelle propre à l’ACC l’a diffère du CCMQ, ces deux regroupements tiennent néanmoins en une recherche par le nombre, à se donner les moyens de présenter des collections, pour acquérir plus de liberté et pouvoir davantage développer une création originale.
En accord avec cette volonté, l’ACC développe une filiation avec les grands fabricants nationaux de textiles, CIL, DuPont Canada et Dominion Textiles, puisque comme le précise Raoul-Jean Fouré, « for Canadian prestige we want to show what can be done by Canadian designers using only Canadian textiles ». Et, bien que la majorité des tissus que produisent ces manufacturiers fussent conçus à partir de fibres synthétiques, dont l’exploitation est alors en plein développement et source de défis importants en raison de la nature des matières premières, cet accord occasionne néanmoins un approvisionnement en grande quantité.
Pourtant, malgré leur volonté et les défilés qui en résulteront ici comme à l’étranger, le premier et le plus connu aura lieu, le 7 décembre 1954, à l’Hôtel Pierre, de New York, certains historiens de la mode semblent affirmer que l’ACC n’a pas eu d’influence marquante sur la mode québécoise, ni montréalaise. Pour reprendre les propos de Françoise Dulac, « s’ils ont répondu à une clientèle privé et prestigieuse, leurs créations n’ont pas atteint les scènes internationales ni le grand public. Elles ont par contre contribué à la diffusion des nouvelles tendances de mode par le biais d’une certaine élite [principalement anglophone] et des pages des journaux ». Est-ce l’un des points qui explique que nous échappons ici en ces temps de crises identitaires et sociétales et au retour aux sources qu’elles provoquent, à la tendance de « ressusciter » des marques prestigieuses, mais depuis des années inactives? Ou est-ce dû au fait que dans cette quête de l’éphémère, certains croient qu’avoir un passé équivaut à être vieux?
Pourtant, à la lecture des articles suite au défilé de l’Hôtel Pierre, leur avenir semblait prometteur. Certains journalistes, parmi lesquels étaient présents ceux du Vogue et du Harper’s Bazaar, se dirent surpris par un défilé axé sur l’élégance et la créativité plutôt que sur les fourrures et les épais lainages auxquels est associé le Canada.
Mais, comme nous l’avons mentionné, l’ACC fut fondée à l’apogée de la haute couture, le monde et celui de la mode allaient connaître plusieurs changements majeurs durant la décennie des années 1960, ne serait-ce qu’en raison de l’avènement du prêt-à-porter. Ainsi, pour être honnête, la fin des activités en 1968, ne revient donc pas entièrement aux couturiers, mais aussi à ce début des temps nouveaux pour reprendre la chanson de Stéphane Venne (1941) et interprétée par Renée Claude (1939), en 1970.
Photographie :
People. Salon Marie Paule, 1945.
Photo Conrad Poirier. Bibliothèque et Archives nationales du Québec,
P48.S1.P12343
RÉFÉRENCES :
BARIL, Gérald, Dicomode : dictionnaire de la mode au Québec de 1900 à nos jours, Montréal, Éditions Fides, 2004, 382 pages.
BORBOËN, Véronique, Esther TRÉPANIER, Mode et apparence dans l’art québécois 1880-1945, Québec, Publications du Québec, Coll. Arts du Québec, 2012, p.207.
DULAC, Françoise, Mode, société et apparences, La mode féminine au Québec de 1945 à 2000, Québec, Université Laval, 2003, 307 pages.
PALMER, Alexandra, « The Association of Canadian Couturiers » in PALMER, Alexandra (sous la dir.), Fashion A Canadian Perspective, Toronto/Buffalo/London, University of Toronto Press, 2004, p.90-109.
- Se connecter ou créer un compte pour soumettre des commentaires