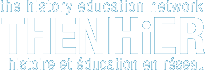Finalement, quelles sont vos croyances épistémiques sur l’histoire? (Bruce VanSledright)

Vous pouvez recueillir de l’information sur un évènement historique jusqu’à un certain point, mais selon les documents que vous choisissez ou les personnes à qui vous parlez, il y aura toujours des biais, enfin je crois…
Cette explication a été donnée par une enseignante d’histoire expérimentée répondant à la question d’un de mes étudiants qui cherchait à comprendre la provenance de la connaissance historique et la façon dont cette connaissance peut être validée. Ce type de questions découle de mon dernier programme de recherche qui vise à découvrir comment les croyances épistémiques des collégiens et des enseignants d’histoire façonnent la manière dont ils réfléchissent à la nature de l’histoire et au savoir historique et comment ces croyances influencent la pratique des enseignants.
Dans ma quête pour saisir comment les personnes apprennent à comprendre le passé, j’ai découvert que les croyances épistémiques sur la nature du savoir historique exercent une influence prépondérante. Dans mes premières recherches avec les enfants, la plupart d’entre eux semblaient penser que le passé et l’histoire étaient la même chose, qu’on pouvait simplement regarder des objets du passé et qu’ils révéleraient l’histoire telle qu’elle s’était réellement passée. Toutefois, en présence de témoignages contradictoires sur un évènement passé, ces enfants étaient mystifiés et l’histoire s’arrêtait. Le passé devenait incompréhensible et ils haussaient souvent les épaules en signe d’impuissance quant à la suite des choses.
Avec de jeunes enfants, cela ne devrait guère nous surprendre. Par contre, des étudiants avec une majeure en histoire et des enseignants d’histoire expérimentés ont manifesté des croyances similaires et se sont retrouvés confrontés au même problème, tenter de donner un sens à un passé empreint de perspectives multiples et aux récits qui en découlaient. Par contre, leur résignation – et parfois leur indifférence ou leur consternation – était un peu plus troublante. On retrouve un peu des trois dans la citation de l’enseignante au début de cet article, spécialement là où sa voix s’estompe.
Il était donc logique de chercher à savoir comment des enseignants d’histoire traiteraient, par exemple, des témoignages conflictuels en classe. Quelles stratégies utiliseraient-ils si les élèves manifestaient des opinions très arrêtées sur des évènements du passé et que ces opinions différaient de l’histoire officielle qu’on leur demandait d’enseigner? Dans les classes que j’ai observées, j’ai généralement obtenu deux réponses : balayer le problème sous le bureau (c.-à-d., ignorer la question, changer le sujet) ou faire une distinction entre les faits historiques réels et l’opinion subjective (sans fondement?) des gens, opinion à laquelle ils ont d’ailleurs droit; cette dernière réponse était celle à laquelle les opinions de la plupart des gens étaient présumées appartenir. Le problème pouvait être transcendé en se concentrant sur des faits réels et en écartant les opinions, biaisées par nature. Par contre, la façon d’y arriver était rarement évidente.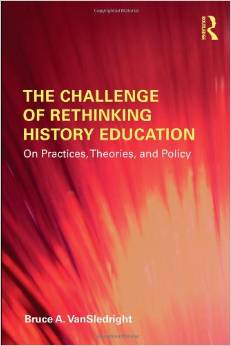
Le travail empirique que j’ai fait plus récemment avec mes collègues Liliana Maggioni et Kimberly Reddy nous a permis de donner un sens à la problématique des croyances épistémiques. Dans ce contexte, faire de l’histoire – c’est-à-dire tenter de comprendre ce qui est arrivé dans le passé, comment les personnes agissaient, comment elles se percevaient dans ces contextes et pourquoi – plonge les chercheurs dans de grands questionnements sur l’interprétation. Quelle est la limite de tolérance dans l’interprétation? Si nous cherchons des faits concrets et que nous faisons confiance aux objets du passé pour nous révéler l’histoire de façon explicite (objectivisme naïf), nous ne pourrons aller bien loin. D’un autre côté, si nous nous résignons à être les chercheurs subjectifs de l’histoire et de ses nombreux flottements, il semble qu’il ne nous reste qu’une forme naïve de subjectivisme (une interprétation biaisée en vaut bien une autre).
Dans les classes d’histoire et dans les réponses des collégiens, nous avons observé des vacillements entre ces deux pôles de croyances épistémiques. Il apparaissait illusoire de coordonner le rôle de celui qui sait (le sujet) avec ce qui peut être appris (des objets) et donc revendiqué comme étant un savoir sur le passé. Il ne semblait pas y avoir de critères et de méthodes pour arbitrer toute licence d’interprétation. Nos données ont démontré que les futurs enseignants et les enseignants en pratique vacillaient épistémiquement. Faire de l’histoire s’est alors arrêté. À cause de cette impasse, plusieurs enseignants en pratique ont exclu la recherche de leurs répertoires pédagogiques.
Au cours des trente dernières années, de nombreuses recherches en pensée historique ont défendu les intérêts de l’histoire comme véhicule pour approfondir la compréhension. Cultiver le processus réflexif en faisant de l’histoire semble toutefois requérir une certaine clarté épistémique ainsi que des critères et des méthodes pour traiter la question de licence d’interprétation. Quelles approches nous y mèneront? Qui est le mieux placé pour faire ce travail? Dans quels contextes : la didactique, les cours d’histoire, le perfectionnement professionnel, les trois? Selon moi, il se fait trop peu de recherches sur les croyances épistémiques en histoire. Il faut accroître la concertation si nous voulons continuer de voir évoluer l’histoire comme moyen principal par lequel les jeunes apprenants approfondissent leur compréhension du passé. L’article que j’ai corédigé avec Kimberly Reddy, « Changing epistemic beliefs? An exploratory study of cognition among prospective history teachers », publié dans Tempo e Argumento [6 (11) (2014): 28-68], en est un bon exemple.
- Se connecter ou créer un compte pour soumettre des commentaires
- English