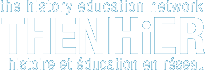Ce que peuvent nous révéler les sources ou le jeu de pistes de la documentation (Première partie)
9 August 2015 - 4:56pm
Dans le cadre des préoccupations qui animent le quotidien du chercheur, se dresse inéluctablement celle de l’emploi des sources, visuelles et écrites. Que dévoilent-elles, quels propos ou vision soutiennent-elles? L’érudit doit-il prioriser les sources premières, Mémoires ou Souvenirs des contemporains de l’époque qu’il étudie? Les ouvrages de référence, puisque issus de travaux savants, sont-ils au-dessus de tout soupçon partisan, contrairement à d’autres genres littéraires?
C’est à ces interrogations que nous attarderons par le biais des enjeux que ces sources ont sur notre recherche doctorale et professionnelle, où nous nous intéressons aux prémices du système contemporain de la mode au milieu du XIXe siècle, à la compréhension et à la promotion de son patrimoine. Présentée en deux parties, notre réflexion bien qu’embryonnaire, portera sur certains faits que nous considérons actuellement lors de nos observations (journaux illustrés, photographies, …) et consultations (romans, ouvrages de référence, …). Afin, d’alléger le propos et lui retirer un aspect trop méthodologique, nous avons pris néanmoins le parti de concentrer nos efforts sur deux exemples, les journaux illustrés et les romans.
Les sources visuelles, l’exemple des journaux illustrés
Si une majorité d’historiens de la mode s’accordent pour identifier l’ouverture de la maison Worth & Bobergh, durant l’hiver 1857-58, comme l’origine du système contemporain de la mode, ce qu’affirment l’instauration de la Chambre syndicale de la couture et de la confection pour dames et fillettes, puis l’apparition de la mention « couturier » dans le bottin du commerce, en 1868 et 1884 respectivement, est-ce que les modèles publiés de la jeune maison de nouveautés et ceux des autres, dans les périodiques reflètent la réalité quotidienne? En regardant le nombre imposant de publications actuelles, papier et numérique, il n’est pas anodin de préciser que cette interrogation nous pouvons l’appliquer à notre contemporanéité. Ainsi, bien que considérant l’affirmation de l’historien Philippe Roche, quant à la diffusion dans l’ensemble de la société française, d’un sous-vêtement emblématique, « […] durant le règne des crinolines, toutes ces robes du terroir si « typiques » se voient pourvues d’un nouveau développement en largeur», il est probable que la réponse soit négative. Comme l’expose l’historienne du costume Françoise Tétart-Vittu, lors de l’exposition temporaire Au paradis des dames : nouveautés, modes et confections, 1810-1870, en 1992, la sélection et la publication dans certains journaux de mode illustrés ou d’informations générale et mondaine correspondaient à la clientèle recherchée par Charles Frederick Worth (1825-1895), ce qui explique que les périodiques plus traditionnels n’aient pas référé au travail de ce dernier.
Il nous faut aussi rappeler que les gravures qui accompagnent ces publications, représentent aussi, bien qu’elles s’insèrent dans une mode qui semble uniforme en raison d’une silhouette caractéristique, des vêtements qui étaient destinés dans un premier temps à une classe sociale spécifique, qui souvent s’apparentait à celle du demi-monde issu ou fréquentant les théâtres, ceux des Variétés ou des Bouffes-Parisiennes dans la Capitale française, par exemple.
Bien que cet énoncé surprenne, choque, il reste que ce milieu où cette classe « piochait » une grande partie de ses membres, à l’exemple du personnage de Nana, dans le roman éponyme de l’écrivain naturaliste Émile Zola (1840-1902), était un endroit privilégié pour lancer durant la saison hivernale, une nouveauté vestimentaire ou « autre ». Nous rappelons combien Thérèse Lachmann (1819-1884), bientôt connue comme La Païva, profita des conseils et toilettes de Camille (?-?), une ancienne apprentie de la couturière Mademoiselle Palmyre (?-?) , comme de sa loge au Royal Opera House, le Covent Garden, lors de son voyage à Londres en 1848, pour amorcer sa fructueuse « carrière ».
Malgré qu’il s’agisse d’une anecdote mais non exclusive en raison du nombre d’émules qui prolifèrent en France au XIXe siècle et jusqu’à la Grande Guerre, il reste que cette association entre mode et demi-monde s’explique par le contexte psychosociologique dans lequel s’inscrit la nouveauté. Effectivement, cette dernière par ses manifestations récentes, est toujours jugée extrême dans les premiers temps. Ses toilettes tapageuses, pour reprendre le titre d’une pièce de théâtre, qui habillent la maîtresse sont refusées à l’épouse légitime et vertueuse, comme le prescrivent les manuels de savoir-vivre du XIXe siècle, « l’exagération des modes n’appartient qu’aux parvenus ou aux femmes d’une vie équivoque» . Et, bien que ces deux milieux soient enclins à une fascination réciproque, ce n’est que suite à une appropriation sociale qui résulte d’une visibilité, d’une diffusion que le demi-monde procure à la nouveauté, et à laquelle participent aussi les périodiques illustrés, que la bourgeoisie parvenue, puis l’aristocratie s’en vêtent, et qu’une diffusion descendante en découle à travers l’ensemble des diverses couches de la société urbaine et provinciale. Cette réalité fit d’ailleurs écrire à Madame Émile de Girardin (1804-1855), née Delphine Gay, le 27 avril 1839, propos aujourd’hui réunis sous les Lettres parisiennes, que, « la Chaussée-d’Antin propose, le faubourg Saint-Honoré adopte, le faubourg Saint-Germain consacre, le Marais exécute et enterre ».
Mais, est-ce qu’un processus de diffusion similaire avait lieu ici? Il s’agit d’une question à laquelle en raison de l’avancement actuel de nos recherches nous pouvons que partiellement répondre, bien que nous envisagions que cela s’avère peu probable. En effet, l’ère victorienne en raison de la réserve qui lui est implicite, fait en sorte que le demi-monde, à condition qu’il en ait eu un, ne semble pas avoir défrayé les manchettes des journaux. L’appropriation et la diffusion de la mode s’en voient donc modifiées, d’autant que cette dernière n’est qu’adaptée ici. Elle n’y est pas conceptualisée. Outre les achats effectués lors des voyages en Europe par l’élite canadienne en quête d’exclusivités, les nouveautés par le biais d’illustrations arrivent au Canada principalement et directement de Paris ou après avoir transigées par l’Angleterre. Montréal et Liverpool sont en effet reliées à compter de 1858, par un service postal hebdomadaire. Certes, habitués à l’influence des grandes villes nord-américaines, Boston, Philadelphie et New York, nous sommes tentés de croire que nos prédécesseurs marquaient un certain retard face à elles. Pourtant, les travaux de la conservatrice émérite au musée McCord, Jacqueline Beaudoin-Ross, sur les gravures de mode, démontrent une autre réalité. Ses recherches font plutôt état d’une publication locale suite à des modifications répondant à des goûts plus simples et à une recherche de confort, dans un délai de deux à trois mois, suivant une première parution à Paris ou à Londres, alors qu’à New York, elle marque parfois un retard d’une année. Cette relative avant-garde nationale explicite donc le fait que dans le processus d’appropriation et de diffusion, certains membres de l’élite, par leurs relations entretenus avec l’Europe, ont joué un rôle similaire à celui de la bourgeoisie parvenue parisienne, non à celui des provinciaux.
Mais, qu’est-il advenu de tous ces vêtements dont l’image fut gravée? En effet, malgré la mention de leur provenance, certains journaux dans une rigueur d’exactitude identifiant même le parfum que doit porter la lectrice pour ressembler à la femme représentée, faute d’un nombre important dans les collections textiles muséales, outre quelques exemples, dont l’association que nous avons effectuée, en raison d’une certaine similarité entre l’une des deux toilettes, présentée sur la gravure « Costumes de Bains de Mer », tirée de La Mode Illustrée, et l’ensemble de promenade (jupe et paletot), vers 1866, conservé au Musée de la Mode de la Ville de Paris, le Musée Galliera (inv.GAL1920.1.2298.0), rien ne prouve que ces ensembles aient finalement existés.
- Se connecter ou créer un compte pour soumettre des commentaires